L’ouvrage du professeur Sari Camille interpelle aussi bien les académiciens, pour définir ensemble, une problématique de la stratégie d’intégration des pays de l’UMA et particulièrement les économies locomotives, que les décideurs publics sur les bénéfices d’une meilleure coordination économique dans un premier temps et d’une intégration progressive dans une seconde période. Les soubassements théoriques actualisés d’un tel processus sont décrits succinctement mais avec brio par le professeur Sari qui a eu le mérite de clarifier l’ensemble des outils de l’appareil analytique nécessaire au management de l’intégration. Les expériences de nombreuses nations tels les ex-pays de l’est sont évoquées partout ou leur pertinence est avérée. Ainsi, le lecteur aura un référentiel aussi bien théorique que pratique sur les thèmes qui sont abordés pour enclencher le processus d’intégration. Les schémas et les modèles présentés sont superbement simplifiés ; ainsi, ils deviennent accessibles à un étudiant ayant abordé un cours d’introduction à l’économie monétaire ou a un praticien qui a eu œuvré pendant une certaine période dans les sphères de décisions.
Toutes les analyses sont présentés et détaillées. Elles ont deux objectifs. Le premier consiste à fournir au lecteur les outils nécessaires pour comprendre le processus d’intégration. Le second consiste à montrer les bénéfices que les différents pays peuvent tirer d’une meilleure coordination des politiques économiques et d’une intégration graduelle et irréversible. Les politiciens ne ratent aucune occasion pour affirmer leur volonté d’aller en ce sens, édifier en commun un ensemble économique fort, sur la base des intérêts mutuels, et occulter les divergences politiques qui minent le processus. Les peuples et surtout les élites tentent de réaliser quelques projets ensemble, au sein d’un contexte qui aide peu ces initiatives. Ils n’attendent que la mise en pratique de mécanismes d’incitation forts pour s’investir massivement dans une telle aventure. Hommes d’affaires, scientifiques, classe laborieuse et citoyens de tout bord réclament haut et fort la mise en place d’une stratégie de collaboration, à l’instar des pays européens et à un degré moindre les pays du Golfe, pour tirer profit des atouts dont dispose la région.
Il est vrai que nous pouvons noter le peu d’ouvrages et même de projets de recherches sur la question. Les intellectuels l’ont occulté non pas par désintérêt mais simplement parce qu’ils considèrent qu’elle fait peu partie de l’agenda politique des différents pays. Il est prématuré de tirer des conclusions sur les causes profondes d’une telle défaillance. Mais l’ouvrage de Mr Sari comble une partie de cet écart et fait partie des pionniers dans ce domaine. Il nous montre que combien même les cheminements de politiques économiques ont été différents en Algérie et au Maroc, il reste suffisamment de marge de manœuvre pour tirer profit des différences naturelles, technologiques et scientifiques.
Mais l’ouvrage est centré sur les questions monétaires : endettement, taux de change, inflation, productivité et le reste. L’auteur fait bien de décrire en profondeur ces thèmes car ce sont les instruments de régulation, les outils que doivent manipuler les pouvoirs publics pour aboutir à un système de coordination harmonieux. Pour le reste : investissements, projets concrets, collaboration scientifique etc. ce seront les acteurs du terrain qui auront à gérer le processus. Les hommes d’affaires, les scientifiques, les ONG, les syndicats et les simples citoyens des deux pays n’attendent qu’un signal fort de la part des pouvoirs politiques pour commencer à construire le Maghreb de demain. Mais les états auront besoin de mettre en place un cadre macroéconomique pour orienter et juguler le processus. C’est dans ce contexte que l’ouvrage du professeur Sari prend toute sa signification. Il comble un énorme vide et serait grandement apprécié au fur et à mesure que l’on s’oriente vers la construction du Maghreb.
Nous pouvons aussi noter que cette investigation tire profit des leçons des réussites et des échecs d’autres ensembles comme l’union européenne. Nous avons grandement besoin de connaître les succès et les échecs des autres tentatives afin de mieux se préparer. L’expérience grecque est analysée en ce sens. Nous pouvons dire que cet ouvrage vient à point nommer pour conquérir un terrain vierge mais vital pour la survie des pays de la région dans un contexte d’économie mondialisée, sur financiarisée et au sein de laquelle il faut gérer aussi bien pour la croissance que les mauvais jours.
L’ouvrage ne peut pas être exhaustif sur toutes les questions. Mais il s’adresse à l’essentiel. Il ne manquera pas de susciter un énorme engouement aussi bien sur la question de l’intégration maghrébine que pour les modalités macroéconomiques. Tant mieux, nous avions déjà besoin de cette analyse depuis fort longtemps. Il reste juste à espérer que ce débat poussera les décideurs politiques à produire des décisions courageuses dans le sens d’une construction plus rapide et plus poussée du grand Maghreb.
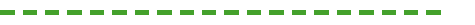
Abdelhak LAMIRI
Ph.D. en sciences de gestion de l’Université de Californie
